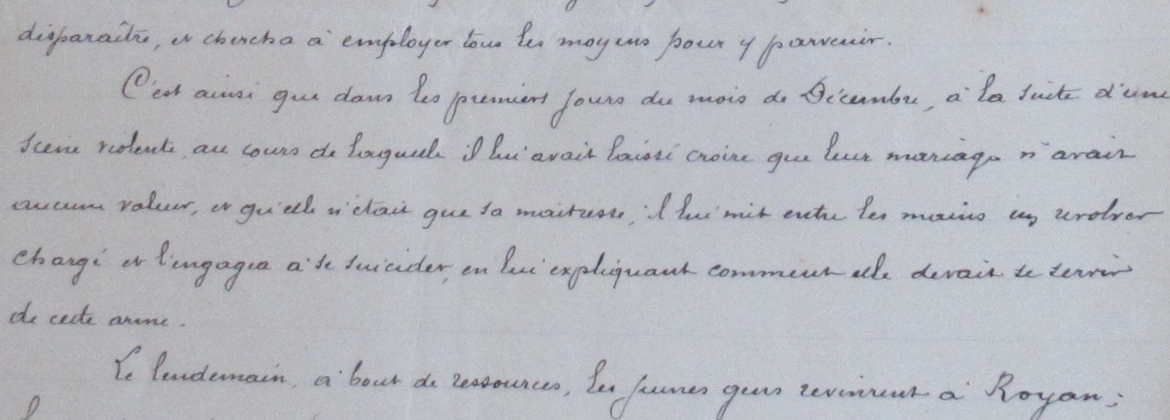Élodie Darmont
Résumé
Que ce soit dans l’espace public ou dans le cadre privé, la volonté de surveiller les femmes est réelle entre 1870 et 1914. Cette surveillance permanente doit permettre de mieux les contrôler et de les circonscrire dans un rôle social et familial convenu par une société patriarcale. Dans l’espace public, cette surveillance passe à la fois par les institutions, les autorités policières et judiciaires et s’exerce encore dans le milieu professionnel. Dans le cadre privé, l’enjeu le plus prégnant est celui qui tourne autour du contrôle du corps des femmes. Cette question met également en jeu l’honneur des femmes, qui ne se heurte pas aux mêmes problématiques que celui des hommes. Le cas de la Charente-Inférieure permet de mettre en lumière quelques-uns des moyens mis en œuvre pour y parvenir.
Détails
Chronologie : XIXe siècle – XXe siècle
Lieux : France
Mots-clés : Révoltées – rebelles – résistances – contestations – femmes – Charente-Inférieure – surveillance – violence – contrôle – fin XIXe siècle – début XXe siècle – 1870-1914
Chronology: XIXth century – XXth century
Location: France
Keywords: Revolt – rebels – Resistance – protest – Women – Charente-Inférieure – surveillance – violence – control – late 19th century – early 20th century – 1870-1914
Plan
I – Surveiller et contrôler les femmes dans l’espace public et professionnel
1. Surveillance et contrôle institutionnel et professionnel
2. La prostitution : un « modèle » de surveillance et de contrôle des femmes ?
II – Réprimer, punir et contraindre les femmes dans la sphère privée
1. Maternité et corps : enjeux et perception des avortements, infanticides et suppressions d’enfants
2. Suicide, vitriol, adultère : l’honneur en jeu et le traitement différencié des individus
3. L’ultime sentiment de contrôle masculin sur les femmes : menacer, battre, tuer
Pour citer cet article
Référence électronique
Darmont Élodie, “« Malheureuse, tu ne seras pas à d’autres qu’à moi » De la surveillance publique aux violences privées : garder le contrôle sur les femmes de Charente-Inférieure entre 1870 et 1914", Revue de l’Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest [En ligne], n°4, 2024, mis en ligne le 5 décembre 2024, consulté le 30 janvier 2026 à 18h03, URL : https://ajco49.fr/2024/12/05/malheureuse-tu-ne-seras-pas-a-dautres-qua-moi-de-la-surveillance-publique-aux-violences-privees-garder-le-controle-sur-les-femmes-de-charente-inf
L’Auteur
Élodie Darmont
Doctorante en histoire contemporaine à l’Université de La Rochelle, sa thèse s’intitule « Révoltées et rebelles. Résistances et contestations féminines en Charente-Inférieure (1870-1914) », sous la direction de Mickaël Augeron. En parallèle, elle est enseignante de Lettres-Histoire et formatrice dans l’académie de Guadeloupe.
Droits d’auteur
Tous droits réservés à l’Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest.
Les propos tenus dans les travaux publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le recours des hommes à la violence ou à la menace contre les femmes sert deux objectifs : l’un est d’exclure les femmes de certains domaines ou de restreindre leur champ d’action, l’autre de les obliger à un certain comportement[1] »
La sociologue britannique Jalna Hanmer, dont les recherches portent sur l’après Seconde Guerre mondiale, montre clairement que la volonté de contrôler les femmes se traduit par une coercition génératrice de violence envers ces dernières. Entre 1870 et 1914, la répartition genrée des rôles est elle aussi très forte, héritière des périodes précédentes et plus particulièrement de la Révolution de 1789. L’instabilité politique forte du XIXe siècle, spécialement celle des années 1870, est peu favorable aux revendications des femmes et à leur émancipation. Au contraire, la stabilité dans les rapports de genre est même considérée comme fondamentale dans la construction des nouvelles institutions républicaines[2]. À cet égard, la Charente-Inférieure offre un prisme intéressant pour étudier ces problématiques. La diversité de son territoire, essentiellement rural mais maillé de petites villes réparties entre le littoral et l’intérieur des terres, le rend particulièrement intéressant. Département longtemps bonapartiste et même boulangiste[3] en 1889, la Charente-Inférieure semble pencher du côté de la stabilité, de l’ordre et des traditions. Pour autant, la perméabilité qu’induit le développement du chemin de fer et des stations balnéaires, va l’obliger à se tourner vers la modernité et les influences extérieures.
Cela n’empêche pas les autorités, en Charente-Inférieure comme ailleurs, de vouloir imposer un fort contrôle sur les femmes, autant en dehors qu’à l’intérieur du foyer. On peut alors se demander quels sont les moyens mis en œuvre pour contraindre les femmes à se conformer à la place que la société leur a attribuée ? Pour cela, nous nous pencherons d’abord sur les moyens de surveillance et de contrôle des femmes employés dans l’espace public et professionnel, avant de nous intéresser aux répressions, punitions et contraintes que peuvent rencontrer les femmes au sein de la sphère privée.
I. Surveiller et contrôler les femmes dans l’espace public et professionnel
1. Surveillance et contrôle institutionnel et professionnel
S’appuyant sur les philosophes de l’Antiquité, tels que Platon ou Hippocrate, mais aussi sur les textes religieux, le XIXe siècle ancre la misogynie dans les esprits et les mentalités masculines et parfois féminines[4]. Ce mythe du « sexe faible » est relayé par les sciences, à commencer par la médecine, alors en plein développement, et à laquelle une scientificité reconnue donne à la parole des médecins force de loi[5].
Ces théories s’affirment tout au long du XIXe siècle et renforcent les inégalités entre hommes et femmes énoncées dans le Code civil. Sa rédaction (1800-1804) met un coup d’arrêt définitif aux idéaux d’émancipation et d’égalité véhiculés dans les Salons du XVIIIe siècle et cherche à réduire les fonctions des femmes à l’espace privé, réservant à l’homme (père ou mari) le pouvoir sur la femme (fille ou épouse). Ainsi est-ce le cas de l’emblématique article 213 qui édicte le fait que « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ».
En renfort du Code civil, le Code pénal consolide ces normes sociales. Ensemble, ils donnent davantage de libertés et de pouvoir aux hommes et se montrent plus répressifs envers les femmes. Les articles 229 et 230 du Code civil rappellent par exemple que l’époux est libre de demander le divorce en cas d’adultère. A contrario, l’épouse ne peut accéder au même droit que si son mari entretient sa concubine au domicile conjugal. Cela laisse peu de champ d’action à l’épouse trompée. Le Code pénal, quant à lui, se montre plus sévère avec les épouses adultères (3 mois à deux ans de prison, article 337) qu’avec les maris (amende de 100 à 1000 francs, article 339). En effet, contrairement à l’adultère masculin, celui des femmes est davantage susceptible de « perturber l’ordre familial » parce qu’il peut entraîner une naissance illégitime[6]. Concrètement, en Charente-Inférieure, entre 1870 et 1914, sur 127 adultères recensés, femmes et hommes sont tout autant condamnés, mais les femmes font davantage de prison (42 % des cas) que les hommes (25 %)[7]. Cette peine est plus infamante et a pour but de davantage marquer les esprits. Elle permet également de contrôler la sexualité féminine en dehors du mariage car celle-ci est mal considérée et renforce l’image de la femme dont l’utérus serait le maître des pensées et le vecteur de nombreuses maladies qu’il est nécessaire de limiter[8]. Enfin, le Code pénal permet au mari de suspendre la peine de son épouse s’il consent à la reprendre (article 337), ce qui lui donne pouvoir et contrôle sur celle-ci, y compris celui de se montrer magnanime en « pardonnant », créant ainsi un rapport de force supplémentaire.
Ces textes continuent de s’appliquer, pour la plupart, entre 1870 et 1914. Les lois et préceptes scientifiques, à l’actif des hommes, tout comme les manuels à but éducatif, souvent rédigés par des femmes – Le savoir-faire et le savoir-vivre : guide pratique de la vie usuelle à l’usage des jeunes filles de Clarisse Juranville (1879) par exemple – tendent à imposer l’image de la « femme idéale », confinée à son intérieur, obéissante et soumise, privilégiant avant tout sa famille[9]. Toutefois, ces théories ne pensent pas les femmes en dehors de leurs foyers. Elles montrent la méconnaissance que les penseurs et certaines penseuses ont des réalités quotidiennes de la majorité des femmes, qui, par obligation, essentiellement pour le travail, passent la majorité de leur journée en dehors de leur maison[10].
Les rapports de police qui s’alarment des activités de certaines de ces femmes dans l’espace public montrent bien l’écart entre la réalité et la théorie. Ces dernières, considérées comme déviantes, sont à surveiller afin de les contrôler et de les circonscrire dans l’espoir que leur comportement ne fasse pas tache d’huile. Les archives conservent quelques cas particulièrement représentatifs. On le voit avec Madame Membrard, institutrice, qui tient des conférences à La Rochelle en mai et juin 1910, dans lesquelles elle remet en cause la place des femmes dans la société :
« La mère peut […] être à même d’inculquer à l’enfant les vrais préceptes de la morale [mais] doit au préalable libérer sa conscience de tous les dogmes de la religion, de toutes les superstitions, s’affranchir aussi de l’espèce de tutelle sous laquelle la tiennent les lois des hommes, votées par des hommes et pour des hommes. […] [11] »
Cet extrait du rapport de surveillance de sa conférence, adressé par le commissaire de police au Préfet, montre que les propos tenus par Madame Membrard sont dérangeants d’autant plus qu’elle fait ouvertement référence à « l’essor pris depuis quelques années par le féminisme[12] ». En effet, le sujet est de plus en plus présent dans la presse et le nombre de sociétés féministes augmente à compter des années 1890. À l’origine centrés sur Paris, les différentes sociétés féministes tentent de se développer en province. La venue de Cécile Brunschvicg en Charente-Inférieure en janvier 1914 aboutie par exemple à la création de la Société féministe de Saintes qui présente la même année une pétition en faveur du droit de vote des femmes au Conseil général[13]. Mais, en 1910, Mme Membrard est encore relativement isolée et, suite à ses premières conférences, elle est révoquée par sa hiérarchie qui l’aurait « fait passer pour folle[14] ». Le prétexte de la folie semble être ici un moyen de contrôle de cette femme dont les propos, tenus publiquement, ne paraissent pas convenir à sa hiérarchie professionnelle qui cherche ainsi à se séparer de ce membre gênant.
Cette surveillance des femmes dans un objectif de contrôle est également observable en prison, marquée par le panoptisme développé par Michel Foucault[15]. Nombreuses sont les détenues à écrire aux autorités pour demander à subir leur peine à proximité de leur famille. Ainsi, en 1909, Héloïse Berland émet le souhait de rester près de sa fille afin qu’elle puisse continuer de lui rendre des visites hebdomadaires[16]. Si les requêtes ont souvent des issues favorables, ce système n’en démontre pas moins qu’il s’agit d’un moyen de contrôler les femmes détenues et d’éviter qu’elles ne se rebellent, individuellement ou collectivement.
La volonté de surveillance et de contrôle institutionnels se décline aussi dans le cadre professionnel. Ainsi en est-il des institutrices pour lesquelles nous avons accès à des sources variées qui montrent le degré de surveillance de ces femmes, non seulement observées et jugées par leur hiérarchie mais aussi par leurs concitoyens (maire ou habitants des communes dans lesquelles elles exercent). En 1904, le maire de St-Martin-de-Villeneuve demande la révocation de l’institutrice, Mme Beaudouin. Elle est accusée de se mêler de politique et cela semble menacer la réélection du maire. Ce dernier demande qu’elle soit déplacée immédiatement, afin de ne plus exercer aucune influence dans sa commune. Elle fait alors l’objet d’une surveillance par le sous-Préfet et son inspecteur mais ceux-ci décident de ne pas donner suite[17].
Cette surveillance est un cadre oppressant pour les femmes et devient régulièrement l’objet de contestations. La laïcisation des écoles de filles est un moment particulier de crispations et de résistances. Ainsi, en mai 1900, l’inspection signale au Préfet que « l’institutrice publique congréganiste de Tonnay-Charente a reçu dans son école, contrairement à la loi, de nombreuses élèves provenant de l’école maternelle publique de la même localité, récemment laïcisée[18] ». Il considère que « c’est là une faute grave », qu’elle a agi avec « désinvolture » et doit être révoquée[19]. Tout en étant consciente de la surveillance dont elle est l’objet et des sanctions qu’elle encourt, cette institutrice n’hésite pas à résister à sa hiérarchie afin d’agir comme bon lui semble.
Ces exemples rappellent que la surveillance des femmes est institutionnalisée, dans l’espace public et professionnel, afin de contrôler leurs agissements et de s’assurer qu’ils correspondent bien au modèle féminin que les autorités politiques, scientifiques et religieuses, avant tout masculines, espèrent pouvoir imposer.
2. La prostitution : un « modèle » de surveillance et de contrôle des femmes ?
Dès le début du XIXe siècle, la France s’impose comme modèle réglementariste sous l’influence d’Alexandre Parent-Duchâtelet qui voit la prostitution comme un mal nécessaire mais qui doit être contrôlée : « les prostituées sont aussi inévitables, dans une agglomération d’hommes, que les égouts […] ; la conduite de l’autorité doit être la même à l’égard des uns qu’à l’égard des autres, son devoir est de les surveiller, d’atténuer par tous les moyens possibles les inconvénients qui leur sont inhérents […][20] ». Il préconise ainsi des maisons closes faciles à repérer, gérées par des dames de maison en cheville avec les autorités policières et sanitaires. En dépit de cette ambition clairement affichée, la France ne possède pas un arsenal unifié de lois réglementant et régulant la prostitution[21]. Il s’agit plutôt d’arrêtés municipaux pris localement qui se superposent sans jamais réellement parvenir à répondre aux problématiques rencontrées. Ainsi revient-il au maire, en lien avec le commissaire, d’établir les règles qui s’appliquent dans sa ville, comme le « règlement pour la surveillance des filles publiques et des maisons de tolérance » mis en place à La Rochelle en 1872 et complété par divers arrêtés en 1885, 1889 et 1893[22]. Ce règlement, envoyé à Rochefort, est utilisé par le maire pour rédiger celui de sa ville. Ces textes classent et hiérarchisent les prostituées, « divisées en deux classes : les filles à domicile particulier et les filles de maison[23] […] ». Ce sont ces mêmes hommes qui décident du statut de prostituée d’une femme en la mettant ou non en carte[24]. En janvier 1870, le commissaire central de Rochefort estime qu’Alice Turet et Anna Bon « sont des filles entretenues, mais leur conduite ne donne pas lieu à une mise en carte. ». En revanche, l’année suivante, il insiste pour que le maire prenne « un arrêté qui mette en carte » Marie Fargeat qui « attire chez elle des hommes et des filles prostituées[25] […] ». Ces différents arrêtés permettent de contrôler toute la vie de ces femmes, notamment les lieux qu’elles peuvent fréquenter et à quel moment. Il leur est par exemple défendu « de sortir après dix heures du soir en été, et neuf heures en hiver », « de fréquenter les cafés et cabarets[26] ». Parfois, cette surveillance se fait trop oppressante et certaines n’hésitent pas à s’en plaindre. En 1872, la fille Roblet écrit au maire de Rochefort pour lui demander de « faire cesser de la part de MM. les employés de la police certains abus de leur service […] ». Elle se considère « traquée […], ne pouvant circuler […] tout en observant les heures indiquées pour [les prostituées] » et se retrouve « séquestrée » chez elle depuis huit jours. Cela a des conséquences car elle ne peut « ni aller au marché ni aller même au bouillon y chercher des substances alimentaires » ce qui l’oblige « à faire faire [ses] commissions » par quelqu’un d’autre la contraignant « à une dépense quotidienne [à laquelle] toutes les autres filles en chambre ne sont pas soumises[27] ».
À ces contrôles déjà pesants s’ajoute tout ce qui est lié à la surveillance des corps et des maladies sexuellement transmissibles. Les autorités font donc pression pour que ces femmes se rendent aux visites sanitaires. Ainsi, « les filles en carte qui manqueront de [s’y] présenter […], seront recherchées et conduites au dispensaire pour y être visitées[28] ». Pour autant, la soumission à ce protocole n’est pas évidente. En 1873, la veuve Dupont « supplie [le maire de Rochefort] de ne pas [la] contraindre à la visite car se [sic] serait tout finit [sic] de [son] espoir de [se] marier[29] ». En 1891, Rose Planty « s’est abstenue [de] paraitre » à la visite, bien qu’elle soit « inscrite sur le registre des femmes en carte[30]. »
La surveillance et le contrôle imposés à ces femmes sont renforcés par le pouvoir que les textes donnent aux tenancières des maisons. Ces dernières doivent répondre des écarts de leurs filles et les soumettent donc à une pression supplémentaire. Ainsi, « les maîtresses de maison sont responsables du maintien de l’ordre dans leur établissement », sous peine de fermeture administrative[31]. Ces mêmes maîtresses n’hésitent pas à dénoncer la concurrence, tout comme les filles se surveillent et se dénoncent entre elles. En 1871, Marguerite Vergeade, tenancière de maison à Rochefort depuis treize ans, écrit au maire de la ville dans le but de l’inciter à obliger un certain nombre de femmes à la visite sanitaire, ce qui, selon elle, les contraindraient à quitter la ville afin de pouvoir y échapper[32]. En 1905, Henriette Rideau explique avoir « été mise en carte à la suite d’une lettre adressée contre [elle] à M. le Commissaire Central[33] ».
Enfin, les filles sont également surveillées par leurs familles qui craignent qu’elles ne deviennent prostituées. C’est par exemple le cas de la veuve Blum, de Paris, qui écrit au maire de Rochefort en 1902 afin de « faire toute tentative et démarche nécessaire pour faire réintégrer son domicile maternel à [sa] jeune fille, Lucie Blum âgée de 18 ans qui […] veut rester à Rochefort […] ». En effet, Lucie vient de quitter son emploi pour un nouveau, moins bien rémunéré et sur lequel elle refuse de donner des informations. Sa mère indique que « la connaissant d’un caractère facile à se laisser entrainer », elle veut « à tout prix la mettre hors de portée de mal tourner[34] ».
Cette surveillance donne lieu à des résistances. Elle n’est donc pas suffisante et doit s’accompagner de sanctions. Le problème se pose ici car aucune loi ne permet directement de réprimander les contrevenantes. Ce sont donc les lois relatives à l’ivresse sur la voie publique, au tapage ou encore aux atteintes aux mœurs et la débauche qui sont mobilisées. N’importe quel citoyen peut être visé par ces lois mais il est vrai qu’elles s’appliquent plus particulièrement aux prostituées. On les voit donc apparaître en correctionnelle ou en audience de simple police, mais rarement sous l’appellation de « prostituée », plus souvent comme « fille soumise ». Ainsi, en 1873, Madeleine Ausage est condamnée à trois ans de prison et 300 francs d’amende, « pour avoir, à Rochefort, attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de ses deux filles[35] ». En 1898, c’est « Jeanne Blois, fille soumise à Saintes » qui est condamnée à « 6 jours de prison et 5 fr d’amende, pour outrages à un agent de police et ivresse publique[36] », tandis qu’en 1899, un procès-verbal est dressé contre Victorine Bossard « fille soumise à Saintes, pour contravention à la police des mœurs[37] ». Ces condamnations sont le plus souvent légères et rares sont les femmes qualifiées de proxénètes ou même de maquerelles, ce qui ne les empêchent pas pour autant de tenir des maisons de prostitution. En 1899, une femme de Royan est pourtant condamnée pour ce motif à « 6 mois de prison, 50 francs d’amende et […] [à] la déchéance maternelle[38] ».
Les prostituées évoluent dans une sorte de zone grise. D’une part leur activité est reconnue puisqu’il existe des maisons et des filles mises en carte, le tout régit par des arrêtés municipaux. D’un autre côté, contrairement aux autres citoyens, elles peuvent être emprisonnées sur simple dénonciation d’un agent de police sous prétexte qu’elles sont dehors trop tard ou trop tôt, parce qu’elles sont absentes à la visite ou sur plainte d’un client. Elles ne bénéficient donc d’aucune liberté individuelle et se retrouvent sous la dépendance totale des hommes qui décident de leur sort, y compris pour celles qui tiennent des maisons, qu’elles peuvent voir fermer à tout moment sous n’importe quel prétexte[39].
II. Réprimer, punir et contraindre les femmes dans la sphère privée
1. Maternité et corps : enjeux et perception des avortements, infanticides et suppressions d’enfants
Dans une société qui valorise l’amour maternel et la figure de la mère, la maternité est source d’identité pour les femmes, un moment essentiel de leur vie. Le corps des femmes est donc investi par la politique et le contrôle de la natalité se révèle un enjeu majeur. Néanmoins, toutes les femmes ne peuvent ou ne veulent pas donner naissance à un enfant et ont alors recours à l’avortement, à l’infanticide ou à la suppression d’enfants.
En Charente-Inférieure, sur les 277 crimes impliquant des femmes et jugés en Cour d’assises entre 1870 et 1914, 118 ont trait à cette problématique, soit 39,5 %. Les raisons qui les animent sont nombreuses. Il s’agit le plus souvent de préserver sa réputation, suite à une naissance hors-mariage, surtout à une époque où les jeunes femmes sont très peu informées sur la sexualité et la contraception, contrairement aux hommes, bénéficiant de plus de liberté et davantage initiés à la sexualité avant le mariage[40]. Plus rarement, la décision découle du fait de limiter le nombre de naissances du foyer, afin de préserver le patrimoine familial pour les enfants déjà nés. Les sanctions varient en fonction des situations et, en cas d’avortement, les avortées sont le plus souvent acquittées, la charge de la sanction reposant intégralement ou presque sur l’avorteuse. En Charente-Inférieure, 71,4 % des avorteuses sont condamnées entre 1870 et 1914. Pour ce qui est des infanticides et suppressions d’enfants, 62,4 % des prévenues sont sanctionnées (travaux forcés, prison ou réclusion). Après 1900, les peines de travaux forcés disparaissent totalement et les acquittements se multiplient. S’il est vrai que la question de la natalité préoccupe beaucoup – d’où les lourdes condamnations des avorteuses – on s’intéresse aussi de plus en plus au sort de ces femmes, le plus souvent jeunes, abandonnées par un amant peu scrupuleux. C’est en partie l’objectif de la loi de 1912 sur la recherche en paternité.
Aux peines dissuasives infligées par la justice, s’ajoute le jugement populaire dont la presse se fait l’écho ou l’origine. À Meursac, en novembre 1870, Anne-Marie Lagarre accouche d’un enfant qu’elle déclare mort-né. L’examen médical semble prouver le contraire, mais elle est acquittée. Se substituant à la justice, la presse tente de démontrer qu’elle a bien prémédité son acte, ayant eu « la criminelle pensée de ne pas laisser vivre son enfant et qu’elle a […] exécuté sa résolution coupable[41] ».
Ces cas connus d’avortements (8), d’infanticides (87) et de suppressions d’enfants (23) entre 1870 et 1914, mettent en lumière l’importance des grossesses non désirées, ainsi que l’immense solitude de ces femmes, de la découverte de la grossesse aux procès. Le passage à l’acte est bien souvent décidé et réalisé par une femme seule, parfois avec la complicité d’une parente ou d’une avorteuse, en espérant ne pas trop attirer l’attention de l’entourage. Les hommes quant à eux sont très peu présents dans ces affaires, soit parce qu’ils ont abandonnés leur maîtresse durant la grossesse, soit parce qu’ils ne participent pas à l’avortement ou l’infanticide par ignorance ou désintérêt. Ils sont donc très rarement impliqués par la justice et poursuivis (2 % d’hommes dans les procédures d’infanticides/suppressions d’enfants et 10,7 % pour les avortements en Charente-Inférieure).
2. Suicide, vitriol, adultère : l’honneur en jeu et le traitement différencié des individus
Dans un siècle qui invente la distribution de médailles et de décorations majoritairement pour les hommes, la question de l’honneur est centrale[42]. Celui-ci est alors pensé comme essentiellement masculin, tout comme la problématique de l’adultère dont la différence de traitement est au bénéfice des hommes. Pour autant, les femmes tiennent également à leur honneur et c’est un motif souvent invoqué dans les affaires de vitriol, mais aussi en cas de suicides ou de tentatives.
Pour la Charente-Inférieure, 127 cas d’adultères ont pu être relevés. Jusqu’en 1899, les épouses sont plus lourdement condamnées que leurs amants, ces derniers n’étant d’ailleurs le plus souvent tout simplement ni connus ni dénoncés par leurs partenaires. En revanche, les maris s’estimant bafoués n’hésitent pas à dénoncer leurs femmes. Ces dernières sont alors condamnées majoritairement à de la prison (66 % des femmes entre 1870 et 1899 contre 34 % des hommes) dans un but dissuasif, mais aussi d’exemplarité. Après 1899, les peines tendent à être plus équitables entre les deux personnes impliquées et les condamnations à la prison se réduisent considérablement, jusqu’à devenir quasi nulles à partir de 1910, accompagnant le mouvement qui, depuis 1895, milite en faveur de la suppression de toute sanction pénale de l’adultère[43]. Face au peu de possibilités légales des femmes en cas d’adultère de leur époux, certaines n’hésitent pas à trouver d’autres moyens, plus ou moins radicaux. En 1895, une femme qui a des doutes sur le motif invoqué par son mari pour s’absenter la journée demande à une amie de garder son magasin et se met en route vers le chalet dont il a la garde l’hiver. Sur place, elle s’empare d’une échelle, grimpe jusqu’au premier étage, brise un carreau et constate la tromperie. Le mari et la maîtresse s’enfuient alors, poursuivis par l’épouse, sur la plage de Ronce-les-Bains. Cette dernière tente de s’en prendre à sa rivale mais est interrompue par son mari. Selon la presse, qui relate l’affaire, la maîtresse « a reçu une rude correction de son mari et la femme trompée est allée déposer une demande de divorce[44] ». Si l’affaire est d’abord traitée de manière privée, elle devient vite publique. Les protagonistes semblent alors être « punis » mais là encore, c’est la femme adultère qui paie le plus lourd tribut, ayant à subir la violence physique légale de son mari. Ce sont d’ailleurs bien souvent les femmes qui sont victimes des autres femmes dans ce type d’affaire. Ainsi, en 1880, à Saintes, la comtesse de Tilly s’en prend-elle à la maîtresse de son mari qu’elle asperge de vitriol lorsqu’elle passe devant son domicile. Seule femme de la bonne société poursuivie dans ce type d’affaire, Madame de Tilly est acquittée. Pour justifier son geste, elle n’invoque pas son honneur mais celui de ses deux enfants[45].
Si les affaires de vitriol font grand bruit dans la presse, c’est avant tout parce qu’elles sont révélatrices de peurs sociales, essentiellement masculines. C’est ainsi qu’en 1889, un article laisse transparaître ces sentiments :
« Quand donc infligera-t-on aux femmes qui jettent du vitriol aux visages des hommes quand elles ne sont pas contentes, un châtiment exemplaire et qui donnerait à réfléchir à celles qui voudraient commettre de pareils attentats ? À propos d’une simple querelle, d’un bouton mal cousu, vous verrez bientôt les névrosées assurées d’une quasi-impunité, répandre le vitriol à pleins bols[46] […] »
Pourtant, en Charente-Inférieure, seuls 11 cas sont jugés. Là aussi, c’est souvent le motif de l’honneur qui est évoqué, mais aussi le fait de se faire justice soi-même. En effet, un certain nombre de ces femmes, jeunes, sont séduites puis abandonnées, parfois enceintes, par les hommes auxquels elles s’en prennent. N’ayant aucun moyen légal de les contraindre, elles entendent leur faire porter leur part de responsabilité en les attaquant et en les marquant pour le reste de leur vie. Séduite par son amant, Marie Ducharles finit par tomber enceinte mais celui-ci refuse de l’épouser et de reconnaître l’enfant. Il répand même des rumeurs au sujet de ses mœurs. Elle le retrouve à Royan où il travaille comme cocher pendant la saison balnéaire, mais n’obtient pas plus gain de cause, lui et ses camarades se moquant d’elle et sous-entendant qu’elle a de nombreux amants. C’est là qu’elle se décide à faire usage du vitriol acheté un peu plus tôt, dans le but de se faire justice. L’enquête démontre la bonne réputation de Marie Ducharles face à celle, déplorable, de sa victime. Elle est acquittée, sous les applaudissements du public[47].
Ne pas supporter de voir son honneur et sa réputation entachés peut aussi se révéler être un motif de suicide ou de tentative. La presse les qualifie souvent de « chagrins domestiques », mais ils cachent parfois des abandons de femmes ou de jeunes filles laissées enceintes et qui ont peur de perdre leur emploi, de ne pas pouvoir s’en sortir ou des réactions de leurs familles. En 1873, Marguerite Sarrazin, 24 ans, domestique, se suicide alors qu’elle est malade. Ses maîtres ne disent que du bien d’elle, mais le voisinage fait courir des rumeurs laissant penser qu’elle est enceinte. C’est ce motif, entachant sa réputation, qui la pousse à commettre son geste. En 1899, Augusta Thiébaud, domestique devant quitter sa place et brouillée avec sa famille, tente de se suicider. Elle se voyait déjà dans la plus grande misère et sans ressources ni soutien, ce qui a déterminé son passage à l’acte[48].
La question de la préservation de l’honneur est donc centrale entre 1870 et 1914 et peut mener à des actes extrêmes, parmi lesquels le suicide ou l’agression au vitriol. Il est alors questions ici des moyens mis en œuvre par les femmes pour tenter de préserver honneur et réputation. Si les hommes peuvent également avoir recours à ces extrémités, ils sont plus nombreux à user de violences psychologiques ou physiques envers les femmes.
3. L’ultime sentiment de contrôle masculin sur les femmes : menacer, battre, tuer
Lorsque l’on est à court de recours légaux pour garder l’ascendant sur une femme, la violence, psychologique et/ou physique, devient alors la seule alternative. Si le Code civil reconnaît les mauvais traitements, « excès, sévices ou injures graves » (article 231) comme motifs de divorce, le Code pénal excuse le meurtre de l’épouse par l’époux en cas de flagrant délit d’adultère au domicile conjugal (article 324).
En Charente-Inférieure, on relève 30 meurtres et 33 tentatives sur des femmes entre 1870 et 1914. La majorité (61,9 %) sont des uxoricides. La justice du XIXe siècle s’empare de ces questions et les magistrats, faute de pouvoir changer les lois, procèdent à des ajustements pratiques pour rendre visibles, pensables et condamnables les violences conjugales[49]. Ainsi, 29,3 % des hommes jugés sont acquittés ou reconnus non-coupables, 27,7 % sont condamnés aux travaux forcés, 20 % à la réclusion et 21,5 % à la prison.
Les interrogatoires mettent en lumière les logiques qui poussent les hommes à tuer les femmes. De même, leurs défenses prennent appui sur des représentations communes qui relèvent de biais de genre et renseignent sur les rapports sociaux de sexe[50]. Parfois, l’accusé affirme être trompé par sa victime pour justifier son acte. Lorsqu’il tente d’excuser sa tentative de meurtre sur son épouse, Émile Dubois explique aux magistrats : « Si j’ai agi comme je le faisais c’est parce que j’étais convaincu que ma femme me faisait des infidélités[51] ». À cela s’ajoute des motifs, tel le fait qu’elle ne remplissait pas bien le rôle attendu d’elle. Interrogé dans l’affaire précédente, le fils d’Émile Dubois raconte ainsi que son « père adressait quelques reproches à [sa] mère parce qu’au moment où [ils] arrivi[aient] pour prendre [leur] repas, après [leur] travail, il n’y avait jamais rien de fait[52] […] ». D’autres fois, c’est parce que la victime menaçait de quitter son agresseur ou l’avait fait que celui-ci s’est cru en droit d’attenter à sa vie. Ainsi Marie-François Lorgue tente de justifier le meurtre de sa femme en précisant : « Je voulais absolument obliger ma femme à revenir avec moi par tous les moyens[53] ». En effet, plusieurs accusés laissent transparaître un fort sentiment de possession juste avant le passage à l’acte. Tout en déchargeant son pistolet sur son épouse, Anatole Pilain s’exclame : « Malheureuse, tu ne seras pas à d’autres qu’à moi[54] ».
Les motifs avancés sont donc nombreux et il ne s’agit pas ici de tous les présenter. Dans une société où la réputation et l’honneur sont essentiels, ces exemples mettent en lumière le fait qu’il peut sembler nécessaire à certains hommes de tuer, mutiler, handicaper une femme afin de rester le maître[55]. Malgré ces attaques, répétitives et d’une grande violence, presque toutes les femmes se défendent d’une ou plusieurs manières. Certaines rendent les coups qui leurs sont portés. L’un des témoins de l’affaire Pilain rapporte qu’elle a vu les époux se donner mutuellement des coups, bien que ce soit lui qui fasse le plus souvent usage de violence[56]. D’autres déposent des plaintes contre leurs époux et/ou demandent une séparation de corps ou un divorce. Ainsi Rose Geay dépose-t-elle plainte contre son mari pour « menaces exercées envers elle ». Elle en profite pour relater l’ensemble des sévices qu’il lui fait subir. Le lendemain, elle introduit également une demande de divorce contre son mari[57].
« Si l’on admet que la violence des hommes envers les femmes a pour but de les tenir sous contrôle, alors cela explique aussi bien la violence privée que la violence publique[58] ». En effet, les violences à l’égard des femmes, qu’elles soient institutionnelles, professionnelles ou privée, restent multiformes. Contraindre ou contrôler un individu selon des critères de genre représente ainsi une forme de violence.
Malgré tout, les problématiques domestiques de contrôle et de contrainte par une violence plus ou moins flagrante et légale ne sont pas au centre des revendications des groupes féministes de la fin de la période qui se concentrent davantage sur le travail ainsi que les droits sociaux et politiques. Pour autant, les résistances quotidiennes sont de plus en plus visibles, notamment grâce à la presse, et le regard de la société évolue peu à peu, spécialement lorsque les violences débordent sur l’espace public.
Les républicains, réellement au pouvoir à compter des années 1880, tendent à s’enorgueillir des progrès qu’ils ont fait faire aux droits des femmes, surtout en termes d’éducation[59]. Ainsi, Jean-Octave Lauraine, député de Saintes de 1898 à 1923 mais aussi président du groupe de la Gauche radicale à la Chambre, déclare, dans un discours de juillet 1912 à l’occasion d’une distribution de prix au collège de Jeunes Filles : « profitez, mesdemoiselles […] de ce qu’ont fait les pouvoirs publics, les majorités républicaines persistantes qui, inlassablement, ont travaillé à débarrasser la route que vous suivez de tous ses encombrements moraux et juridiques[60] ». Représentatif de l’état d’esprit dominant, en Charente-Inférieure, en France et dans son parti politique, il se permet toutefois de souligner que ces progrès sont suffisants. Ainsi fait-il remarquer aux jeunes filles qu’il « ne faut pas que cet enseignement vous porte à vous éloigner de la magnifique condition sociale que vous êtes appelées à remplir. Il faut que vous ayez au foyer, que vous devez créer […] – parce que c’est votre devoir, et qu’ayant reçu la vie vous devez avoir à honneur […] de la rendre à votre tour – la deuxième place[61] ». Après cette réassignation de chacun à ses fonctions de genre et soucieux de préserver le modèle social et familial en place, il se permet d’ajouter une mise en garde cherchant à « prémunir [les jeunes élèves] contre cette stupide tendance au féminisme qui tend à faire des femmes des hommes[62] ». Cet avertissement ne semble pas avoir été entendu de toutes puisque la ville de Saintes accueille moins de deux ans plus tard, en janvier 1914, la première société féministe de la Charente-Inférieure.
[1] Hanmer, Jalna, « Violence et contrôle social des femmes », dans Nouvelles questions féministes. Revue internationale francophone, novembre 1977, p. 85.
[2] Bougle-Moalic, Anne-Sarah, Le vote des Françaises. Cent ans de débats, 1848-1944, Presses Universitaires de Rennes, Collection « Archives du féminisme », Rennes, 2021, p. 86.
[3] En référence au général Boulanger et au mouvement politique populiste français qui en découle entre 1885 et 1891.
[4] Gargam, Adeline, Lançon, Bertrand, Histoire de la misogynie. Le mépris des femmes de l’Antiquité à nos jours, Les Éditions Arkhê, Paris, 2020, p. 19.
[5] Ripa, Yannick, Les femmes actrices de l’histoire de France de 1789 à nos jours, Armand Colin, Paris, 2010, p. 26 ; Bannour, Wanda, « L’idéologie du corps médical français au XIXe siècle », dans Les Cahiers du GRIF, n° 47, 1993, p. 51-59.
[6] Mortas, Pauline, « Articles intimes pour dames et messieurs » : une histoire du marché lié à la sexualité (France, années 1880-années 1930), thèse de doctorat en Histoire sous la direction de Rasmussen, Anne, Chaperon, Sylvie et Kalifa, Dominique, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue en décembre 2023 ; Sohn, Anne-Marie, Chrysalides, femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles), Paris, Publication de la Sorbonne, 1996.
[7] Statistiques établis à partir du relevé des peines pour adultère (127 cas recensés, 107 peines connues) dans la presse de Charente-Inférieure sur https://www.retronews.fr, plateforme de mise en ligne de la presse par le BNF.
[8] Gargam, Adeline, Lançon, Bertrand, Histoire de la misogynie. Op. Cit., p. 113-115.
[9] Henck, Véronique, « Images de la femme idéale au XIXe siècle », dans Revue des sciences sociales de la France de l’Est, n° 23, 1996, p. 25-30.
[10] https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/histoire-des-femmes-ecrire-l-histoire-des-femmes-7-10-le-travail-des-femmes-16-paysannes-17-le-travail-domestique-18-ouvrieres-1ere-diffusion-21-au-23-03-2005-2340140, par Michelle Perrot, écouté le 21 janvier 2023.
[11] AD 17, 4M9/1, Réunions publiques, 1907-1921, Courrier du Commissaire central de La Rochelle au Préfet, 22 mai 1910.
[12] Idem.
[13] De telles initiatives se multiplient, au même moment, dans plusieurs autres départements.
[14] Idem, 8 juin 1910.
[15] Foucault, Michel, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1975. À l’origine, le terme désigne l’architecture carcérale imaginée par les frères Jeremy et Samuel Bentham qui a pour objectif de permettre à un gardien de pouvoir observer l’ensemble des prisonniers depuis un même point central. Cela avait pour but de donner aux prisonniers l’impression d’être constamment surveillés, sans vraiment le savoir. Michel Foucault en fait le modèle abstrait d’une société disciplinaire, axée sur le contrôle social.
[16] AD 17, 1Y/142, Requêtes et réclamations des détenues femmes (1830-1924) – Lettre transmise par l’avocat de la prévenue, 12 août 1909.
[17] AD 17, 1T/127, Révocations et suspensions, Affaire Beaudouin – Courriers entre le Préfet et l’Inspecteur, mai 1904-février 1906.
[18] AD 17, 1T/59, Laïcisation des écoles de filles (1896-1904) – Lettre de l’Inspecteur d’académie au Préfet, 12 mai 1900.
[19] Idem.
[20] Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste, De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration, Tome 2, Paris, J.B. Baillière, 1836, p. 513-514.
[21] Corbin, Alain, Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Flammarion, coll. Champs Histoire, 1982.
[22] Archives Municipales de Rochefort (AMR), 1J9 et J10 Prostitution ; VRAC 2I – Extraits des règlements.
[23] AMR, J9, Extrait de règlement.
[24] Il s’agit d’une carte sanitaire délivrée par la police aux « filles » exerçant la prostitution en dehors des maisons closes. Elle permet aux autorités de recenser, surveiller et contrôler les prostituées.
[25] Idem.
[26] AMR, J9 et VRAC 2I – Extraits des règlements.
[27] AMR, J9 – Lettre de la fille Roblet, 25 juillet 1872.
[28] Idem – Extrait de règlement.
[29] Idem – Lettre de la veuve Dupont au maire de Rochefort, 12 juillet 1873.
[30] AMR, J10, Rapport du commissaire central au maire de Rochefort, 22 mai 1891.
[31] AMR, J9 et J10, Extraits des règlements.
[32] AMR, J9, Lettre de Marguerite Vergeade au maire de Rochefort, 4 octobre 1871.
[33] AMR, J11, Lettre d’Henriette Rideau au maire de Rochefort, 30 octobre 1905.
[34] Idem, Lettre de la veuve Blum au maire de Rochefort, 5 mars 1902.
[35] BNF, Les Tablettes des Deux-Charentes, 25 janvier 1873, page 3, colonne 4.
[36] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 19 mars 1898, page 3, colonne 3.
[37] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 1er avril 1899, page 2, colonne 4.
[38] BNF, L’Écho rochelais, 14 juin 1899, page 3, colonne 4.
[39] Zylberberg-Hocquard, Marie-Hélène, « Femmes sans droit/Droits des femmes au XIXe siècle. Les femmes face à la citoyenneté », dans Les cahiers du genre, n° 6, 1993, p. 11-27.
[40] houbre, Gabrielle, “Au XIXe siècle, le retour en force d’une sexualité procréative et normée », propos recueillis par Marina bellot, dans Retronews, site de presse de la BNF, mars 2024, https://www.retronews.fr/societe/interview/2024/03/04/sexualites-au-xixe-siecle, consulté le 4 août 2024.
[41] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 23 février 1871, page 3, colonne 6.
[42] Dumons, Bruno, Pollet, Gilles (dir.), La Fabrique de l’Honneur. Les médailles et les décorations en France, XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009, p. 17.
[43] Martin-Fugier, Anne, La Bourgeoise, Les Éditions Fayard, Pluriel, Rennes, 2014, p. 107.
[44] BNF, L’Écho saintongeais, 28 avril 1895, page 3, colonne 2.
[45] AD 17, 2U3/1683, Affaire Girard du Demaine, Marie-Amélie, épouse Legardeur de Tilly, vitriol.
[46] L’Écho rochelais, 12 janvier 1889, page 3, colonne 4.
[47] AD 17, 2U3/2376, Affaire Ducharles Marie, 1898, Vitriol ; BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 26 novembre 1898, page 2, colonne 5.
[48] BNF, Le Phare des Charentes, 7 juillet 1899, page 3, colonne 3.
[49] Vanneau, Victoria, « L’invention juridique des violences conjugales au XIXe siècle », dans Les cahiers de la justice, n° 2, 2016/2, p. 305.
[50] Giacinti, Margot, « “Débarrasser la société de femme[s] de ce genre-là”. Appréhender les archives judiciaires au prisme du genre pour enquêter sur les féminicides », GLAD!, 11 | 2021. Le biais de genre est ce que l’on projette sur l’autre en raison de son genre. Il reflète les associations que nous avons intégrées au fil de notre vie, dans notre éducation et nos relations sociales.
[51] AD 17, 2U3/2472, Affaire Dubois Émile, Tentative de meurtre, 1901.
[52] Idem.
[53] AD 17, 2U3/2495, Affaire Lorgue Marie-François, Meurtre, 1902.
[54] AD 17, 2U3/1999, Affaire Pilain Anatole, Tentative d’assassinat, 1887.
[55] Hanmer, Jalna, « Violence et contrôle social des femmes », Op. Cit., p. 79.
[56] AD 17, 2U3/1999, Affaire Pilain Anatole, Op. Cit..
[57] AD 17, 2U3/2360, Affaire Terrien Charles-Philippe, Meurtre, 1897.
[58] Hanmer, Jalna, « Violence et contrôle social des femmes », Op. Cit., p. 79.
[59] Entre 1870 et 1880, la République reste fragile. Les républicains sont à l’origine du nouveau régime mais les résultats des élections restent favorables aux monarchistes. Pour autant, après le départ de Mac Mahon, les républicains s’imposent peu à peu et prennent réellement le pouvoir à compter de 1879.
[60] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 23 juillet 1912, page 2, colonnes 2 à 4.
[61] Idem.
[62] Idem.
« Le recours des hommes à la violence ou à la menace contre les femmes sert deux objectifs : l’un est d’exclure les femmes de certains domaines ou de restreindre leur champ d’action, l’autre de les obliger à un certain comportement[1] »
La sociologue britannique Jalna Hanmer, dont les recherches portent sur l’après Seconde Guerre mondiale, montre clairement que la volonté de contrôler les femmes se traduit par une coercition génératrice de violence envers ces dernières. Entre 1870 et 1914, la répartition genrée des rôles est elle aussi très forte, héritière des périodes précédentes et plus particulièrement de la Révolution de 1789. L’instabilité politique forte du XIXe siècle, spécialement celle des années 1870, est peu favorable aux revendications des femmes et à leur émancipation. Au contraire, la stabilité dans les rapports de genre est même considérée comme fondamentale dans la construction des nouvelles institutions républicaines[2]. À cet égard, la Charente-Inférieure offre un prisme intéressant pour étudier ces problématiques. La diversité de son territoire, essentiellement rural mais maillé de petites villes réparties entre le littoral et l’intérieur des terres, le rend particulièrement intéressant. Département longtemps bonapartiste et même boulangiste[3] en 1889, la Charente-Inférieure semble pencher du côté de la stabilité, de l’ordre et des traditions. Pour autant, la perméabilité qu’induit le développement du chemin de fer et des stations balnéaires, va l’obliger à se tourner vers la modernité et les influences extérieures.
Cela n’empêche pas les autorités, en Charente-Inférieure comme ailleurs, de vouloir imposer un fort contrôle sur les femmes, autant en dehors qu’à l’intérieur du foyer. On peut alors se demander quels sont les moyens mis en œuvre pour contraindre les femmes à se conformer à la place que la société leur a attribuée ? Pour cela, nous nous pencherons d’abord sur les moyens de surveillance et de contrôle des femmes employés dans l’espace public et professionnel, avant de nous intéresser aux répressions, punitions et contraintes que peuvent rencontrer les femmes au sein de la sphère privée.
I. Surveiller et contrôler les femmes dans l’espace public et professionnel
1. Surveillance et contrôle institutionnel et professionnel
S’appuyant sur les philosophes de l’Antiquité, tels que Platon ou Hippocrate, mais aussi sur les textes religieux, le XIXe siècle ancre la misogynie dans les esprits et les mentalités masculines et parfois féminines[4]. Ce mythe du « sexe faible » est relayé par les sciences, à commencer par la médecine, alors en plein développement, et à laquelle une scientificité reconnue donne à la parole des médecins force de loi[5].
Ces théories s’affirment tout au long du XIXe siècle et renforcent les inégalités entre hommes et femmes énoncées dans le Code civil. Sa rédaction (1800-1804) met un coup d’arrêt définitif aux idéaux d’émancipation et d’égalité véhiculés dans les Salons du XVIIIe siècle et cherche à réduire les fonctions des femmes à l’espace privé, réservant à l’homme (père ou mari) le pouvoir sur la femme (fille ou épouse). Ainsi est-ce le cas de l’emblématique article 213 qui édicte le fait que « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ».
En renfort du Code civil, le Code pénal consolide ces normes sociales. Ensemble, ils donnent davantage de libertés et de pouvoir aux hommes et se montrent plus répressifs envers les femmes. Les articles 229 et 230 du Code civil rappellent par exemple que l’époux est libre de demander le divorce en cas d’adultère. A contrario, l’épouse ne peut accéder au même droit que si son mari entretient sa concubine au domicile conjugal. Cela laisse peu de champ d’action à l’épouse trompée. Le Code pénal, quant à lui, se montre plus sévère avec les épouses adultères (3 mois à deux ans de prison, article 337) qu’avec les maris (amende de 100 à 1000 francs, article 339). En effet, contrairement à l’adultère masculin, celui des femmes est davantage susceptible de « perturber l’ordre familial » parce qu’il peut entraîner une naissance illégitime[6]. Concrètement, en Charente-Inférieure, entre 1870 et 1914, sur 127 adultères recensés, femmes et hommes sont tout autant condamnés, mais les femmes font davantage de prison (42 % des cas) que les hommes (25 %)[7]. Cette peine est plus infamante et a pour but de davantage marquer les esprits. Elle permet également de contrôler la sexualité féminine en dehors du mariage car celle-ci est mal considérée et renforce l’image de la femme dont l’utérus serait le maître des pensées et le vecteur de nombreuses maladies qu’il est nécessaire de limiter[8]. Enfin, le Code pénal permet au mari de suspendre la peine de son épouse s’il consent à la reprendre (article 337), ce qui lui donne pouvoir et contrôle sur celle-ci, y compris celui de se montrer magnanime en « pardonnant », créant ainsi un rapport de force supplémentaire.
Ces textes continuent de s’appliquer, pour la plupart, entre 1870 et 1914. Les lois et préceptes scientifiques, à l’actif des hommes, tout comme les manuels à but éducatif, souvent rédigés par des femmes – Le savoir-faire et le savoir-vivre : guide pratique de la vie usuelle à l’usage des jeunes filles de Clarisse Juranville (1879) par exemple – tendent à imposer l’image de la « femme idéale », confinée à son intérieur, obéissante et soumise, privilégiant avant tout sa famille[9]. Toutefois, ces théories ne pensent pas les femmes en dehors de leurs foyers. Elles montrent la méconnaissance que les penseurs et certaines penseuses ont des réalités quotidiennes de la majorité des femmes, qui, par obligation, essentiellement pour le travail, passent la majorité de leur journée en dehors de leur maison[10].
Les rapports de police qui s’alarment des activités de certaines de ces femmes dans l’espace public montrent bien l’écart entre la réalité et la théorie. Ces dernières, considérées comme déviantes, sont à surveiller afin de les contrôler et de les circonscrire dans l’espoir que leur comportement ne fasse pas tache d’huile. Les archives conservent quelques cas particulièrement représentatifs. On le voit avec Madame Membrard, institutrice, qui tient des conférences à La Rochelle en mai et juin 1910, dans lesquelles elle remet en cause la place des femmes dans la société :
« La mère peut […] être à même d’inculquer à l’enfant les vrais préceptes de la morale [mais] doit au préalable libérer sa conscience de tous les dogmes de la religion, de toutes les superstitions, s’affranchir aussi de l’espèce de tutelle sous laquelle la tiennent les lois des hommes, votées par des hommes et pour des hommes. […] [11] »
Cet extrait du rapport de surveillance de sa conférence, adressé par le commissaire de police au Préfet, montre que les propos tenus par Madame Membrard sont dérangeants d’autant plus qu’elle fait ouvertement référence à « l’essor pris depuis quelques années par le féminisme[12] ». En effet, le sujet est de plus en plus présent dans la presse et le nombre de sociétés féministes augmente à compter des années 1890. À l’origine centrés sur Paris, les différentes sociétés féministes tentent de se développer en province. La venue de Cécile Brunschvicg en Charente-Inférieure en janvier 1914 aboutie par exemple à la création de la Société féministe de Saintes qui présente la même année une pétition en faveur du droit de vote des femmes au Conseil général[13]. Mais, en 1910, Mme Membrard est encore relativement isolée et, suite à ses premières conférences, elle est révoquée par sa hiérarchie qui l’aurait « fait passer pour folle[14] ». Le prétexte de la folie semble être ici un moyen de contrôle de cette femme dont les propos, tenus publiquement, ne paraissent pas convenir à sa hiérarchie professionnelle qui cherche ainsi à se séparer de ce membre gênant.
Cette surveillance des femmes dans un objectif de contrôle est également observable en prison, marquée par le panoptisme développé par Michel Foucault[15]. Nombreuses sont les détenues à écrire aux autorités pour demander à subir leur peine à proximité de leur famille. Ainsi, en 1909, Héloïse Berland émet le souhait de rester près de sa fille afin qu’elle puisse continuer de lui rendre des visites hebdomadaires[16]. Si les requêtes ont souvent des issues favorables, ce système n’en démontre pas moins qu’il s’agit d’un moyen de contrôler les femmes détenues et d’éviter qu’elles ne se rebellent, individuellement ou collectivement.
La volonté de surveillance et de contrôle institutionnels se décline aussi dans le cadre professionnel. Ainsi en est-il des institutrices pour lesquelles nous avons accès à des sources variées qui montrent le degré de surveillance de ces femmes, non seulement observées et jugées par leur hiérarchie mais aussi par leurs concitoyens (maire ou habitants des communes dans lesquelles elles exercent). En 1904, le maire de St-Martin-de-Villeneuve demande la révocation de l’institutrice, Mme Beaudouin. Elle est accusée de se mêler de politique et cela semble menacer la réélection du maire. Ce dernier demande qu’elle soit déplacée immédiatement, afin de ne plus exercer aucune influence dans sa commune. Elle fait alors l’objet d’une surveillance par le sous-Préfet et son inspecteur mais ceux-ci décident de ne pas donner suite[17].
Cette surveillance est un cadre oppressant pour les femmes et devient régulièrement l’objet de contestations. La laïcisation des écoles de filles est un moment particulier de crispations et de résistances. Ainsi, en mai 1900, l’inspection signale au Préfet que « l’institutrice publique congréganiste de Tonnay-Charente a reçu dans son école, contrairement à la loi, de nombreuses élèves provenant de l’école maternelle publique de la même localité, récemment laïcisée[18] ». Il considère que « c’est là une faute grave », qu’elle a agi avec « désinvolture » et doit être révoquée[19]. Tout en étant consciente de la surveillance dont elle est l’objet et des sanctions qu’elle encourt, cette institutrice n’hésite pas à résister à sa hiérarchie afin d’agir comme bon lui semble.
Ces exemples rappellent que la surveillance des femmes est institutionnalisée, dans l’espace public et professionnel, afin de contrôler leurs agissements et de s’assurer qu’ils correspondent bien au modèle féminin que les autorités politiques, scientifiques et religieuses, avant tout masculines, espèrent pouvoir imposer.
2. La prostitution : un « modèle » de surveillance et de contrôle des femmes ?
Dès le début du XIXe siècle, la France s’impose comme modèle réglementariste sous l’influence d’Alexandre Parent-Duchâtelet qui voit la prostitution comme un mal nécessaire mais qui doit être contrôlée : « les prostituées sont aussi inévitables, dans une agglomération d’hommes, que les égouts […] ; la conduite de l’autorité doit être la même à l’égard des uns qu’à l’égard des autres, son devoir est de les surveiller, d’atténuer par tous les moyens possibles les inconvénients qui leur sont inhérents […][20] ». Il préconise ainsi des maisons closes faciles à repérer, gérées par des dames de maison en cheville avec les autorités policières et sanitaires. En dépit de cette ambition clairement affichée, la France ne possède pas un arsenal unifié de lois réglementant et régulant la prostitution[21]. Il s’agit plutôt d’arrêtés municipaux pris localement qui se superposent sans jamais réellement parvenir à répondre aux problématiques rencontrées. Ainsi revient-il au maire, en lien avec le commissaire, d’établir les règles qui s’appliquent dans sa ville, comme le « règlement pour la surveillance des filles publiques et des maisons de tolérance » mis en place à La Rochelle en 1872 et complété par divers arrêtés en 1885, 1889 et 1893[22]. Ce règlement, envoyé à Rochefort, est utilisé par le maire pour rédiger celui de sa ville. Ces textes classent et hiérarchisent les prostituées, « divisées en deux classes : les filles à domicile particulier et les filles de maison[23] […] ». Ce sont ces mêmes hommes qui décident du statut de prostituée d’une femme en la mettant ou non en carte[24]. En janvier 1870, le commissaire central de Rochefort estime qu’Alice Turet et Anna Bon « sont des filles entretenues, mais leur conduite ne donne pas lieu à une mise en carte. ». En revanche, l’année suivante, il insiste pour que le maire prenne « un arrêté qui mette en carte » Marie Fargeat qui « attire chez elle des hommes et des filles prostituées[25] […] ». Ces différents arrêtés permettent de contrôler toute la vie de ces femmes, notamment les lieux qu’elles peuvent fréquenter et à quel moment. Il leur est par exemple défendu « de sortir après dix heures du soir en été, et neuf heures en hiver », « de fréquenter les cafés et cabarets[26] ». Parfois, cette surveillance se fait trop oppressante et certaines n’hésitent pas à s’en plaindre. En 1872, la fille Roblet écrit au maire de Rochefort pour lui demander de « faire cesser de la part de MM. les employés de la police certains abus de leur service […] ». Elle se considère « traquée […], ne pouvant circuler […] tout en observant les heures indiquées pour [les prostituées] » et se retrouve « séquestrée » chez elle depuis huit jours. Cela a des conséquences car elle ne peut « ni aller au marché ni aller même au bouillon y chercher des substances alimentaires » ce qui l’oblige « à faire faire [ses] commissions » par quelqu’un d’autre la contraignant « à une dépense quotidienne [à laquelle] toutes les autres filles en chambre ne sont pas soumises[27] ».
À ces contrôles déjà pesants s’ajoute tout ce qui est lié à la surveillance des corps et des maladies sexuellement transmissibles. Les autorités font donc pression pour que ces femmes se rendent aux visites sanitaires. Ainsi, « les filles en carte qui manqueront de [s’y] présenter […], seront recherchées et conduites au dispensaire pour y être visitées[28] ». Pour autant, la soumission à ce protocole n’est pas évidente. En 1873, la veuve Dupont « supplie [le maire de Rochefort] de ne pas [la] contraindre à la visite car se [sic] serait tout finit [sic] de [son] espoir de [se] marier[29] ». En 1891, Rose Planty « s’est abstenue [de] paraitre » à la visite, bien qu’elle soit « inscrite sur le registre des femmes en carte[30]. »
La surveillance et le contrôle imposés à ces femmes sont renforcés par le pouvoir que les textes donnent aux tenancières des maisons. Ces dernières doivent répondre des écarts de leurs filles et les soumettent donc à une pression supplémentaire. Ainsi, « les maîtresses de maison sont responsables du maintien de l’ordre dans leur établissement », sous peine de fermeture administrative[31]. Ces mêmes maîtresses n’hésitent pas à dénoncer la concurrence, tout comme les filles se surveillent et se dénoncent entre elles. En 1871, Marguerite Vergeade, tenancière de maison à Rochefort depuis treize ans, écrit au maire de la ville dans le but de l’inciter à obliger un certain nombre de femmes à la visite sanitaire, ce qui, selon elle, les contraindraient à quitter la ville afin de pouvoir y échapper[32]. En 1905, Henriette Rideau explique avoir « été mise en carte à la suite d’une lettre adressée contre [elle] à M. le Commissaire Central[33] ».
Enfin, les filles sont également surveillées par leurs familles qui craignent qu’elles ne deviennent prostituées. C’est par exemple le cas de la veuve Blum, de Paris, qui écrit au maire de Rochefort en 1902 afin de « faire toute tentative et démarche nécessaire pour faire réintégrer son domicile maternel à [sa] jeune fille, Lucie Blum âgée de 18 ans qui […] veut rester à Rochefort […] ». En effet, Lucie vient de quitter son emploi pour un nouveau, moins bien rémunéré et sur lequel elle refuse de donner des informations. Sa mère indique que « la connaissant d’un caractère facile à se laisser entrainer », elle veut « à tout prix la mettre hors de portée de mal tourner[34] ».
Cette surveillance donne lieu à des résistances. Elle n’est donc pas suffisante et doit s’accompagner de sanctions. Le problème se pose ici car aucune loi ne permet directement de réprimander les contrevenantes. Ce sont donc les lois relatives à l’ivresse sur la voie publique, au tapage ou encore aux atteintes aux mœurs et la débauche qui sont mobilisées. N’importe quel citoyen peut être visé par ces lois mais il est vrai qu’elles s’appliquent plus particulièrement aux prostituées. On les voit donc apparaître en correctionnelle ou en audience de simple police, mais rarement sous l’appellation de « prostituée », plus souvent comme « fille soumise ». Ainsi, en 1873, Madeleine Ausage est condamnée à trois ans de prison et 300 francs d’amende, « pour avoir, à Rochefort, attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de ses deux filles[35] ». En 1898, c’est « Jeanne Blois, fille soumise à Saintes » qui est condamnée à « 6 jours de prison et 5 fr d’amende, pour outrages à un agent de police et ivresse publique[36] », tandis qu’en 1899, un procès-verbal est dressé contre Victorine Bossard « fille soumise à Saintes, pour contravention à la police des mœurs[37] ». Ces condamnations sont le plus souvent légères et rares sont les femmes qualifiées de proxénètes ou même de maquerelles, ce qui ne les empêchent pas pour autant de tenir des maisons de prostitution. En 1899, une femme de Royan est pourtant condamnée pour ce motif à « 6 mois de prison, 50 francs d’amende et […] [à] la déchéance maternelle[38] ».
Les prostituées évoluent dans une sorte de zone grise. D’une part leur activité est reconnue puisqu’il existe des maisons et des filles mises en carte, le tout régit par des arrêtés municipaux. D’un autre côté, contrairement aux autres citoyens, elles peuvent être emprisonnées sur simple dénonciation d’un agent de police sous prétexte qu’elles sont dehors trop tard ou trop tôt, parce qu’elles sont absentes à la visite ou sur plainte d’un client. Elles ne bénéficient donc d’aucune liberté individuelle et se retrouvent sous la dépendance totale des hommes qui décident de leur sort, y compris pour celles qui tiennent des maisons, qu’elles peuvent voir fermer à tout moment sous n’importe quel prétexte[39].
II. Réprimer, punir et contraindre les femmes dans la sphère privée
1. Maternité et corps : enjeux et perception des avortements, infanticides et suppressions d’enfants
Dans une société qui valorise l’amour maternel et la figure de la mère, la maternité est source d’identité pour les femmes, un moment essentiel de leur vie. Le corps des femmes est donc investi par la politique et le contrôle de la natalité se révèle un enjeu majeur. Néanmoins, toutes les femmes ne peuvent ou ne veulent pas donner naissance à un enfant et ont alors recours à l’avortement, à l’infanticide ou à la suppression d’enfants.
En Charente-Inférieure, sur les 277 crimes impliquant des femmes et jugés en Cour d’assises entre 1870 et 1914, 118 ont trait à cette problématique, soit 39,5 %. Les raisons qui les animent sont nombreuses. Il s’agit le plus souvent de préserver sa réputation, suite à une naissance hors-mariage, surtout à une époque où les jeunes femmes sont très peu informées sur la sexualité et la contraception, contrairement aux hommes, bénéficiant de plus de liberté et davantage initiés à la sexualité avant le mariage[40]. Plus rarement, la décision découle du fait de limiter le nombre de naissances du foyer, afin de préserver le patrimoine familial pour les enfants déjà nés. Les sanctions varient en fonction des situations et, en cas d’avortement, les avortées sont le plus souvent acquittées, la charge de la sanction reposant intégralement ou presque sur l’avorteuse. En Charente-Inférieure, 71,4 % des avorteuses sont condamnées entre 1870 et 1914. Pour ce qui est des infanticides et suppressions d’enfants, 62,4 % des prévenues sont sanctionnées (travaux forcés, prison ou réclusion). Après 1900, les peines de travaux forcés disparaissent totalement et les acquittements se multiplient. S’il est vrai que la question de la natalité préoccupe beaucoup – d’où les lourdes condamnations des avorteuses – on s’intéresse aussi de plus en plus au sort de ces femmes, le plus souvent jeunes, abandonnées par un amant peu scrupuleux. C’est en partie l’objectif de la loi de 1912 sur la recherche en paternité.
Aux peines dissuasives infligées par la justice, s’ajoute le jugement populaire dont la presse se fait l’écho ou l’origine. À Meursac, en novembre 1870, Anne-Marie Lagarre accouche d’un enfant qu’elle déclare mort-né. L’examen médical semble prouver le contraire, mais elle est acquittée. Se substituant à la justice, la presse tente de démontrer qu’elle a bien prémédité son acte, ayant eu « la criminelle pensée de ne pas laisser vivre son enfant et qu’elle a […] exécuté sa résolution coupable[41] ».
Ces cas connus d’avortements (8), d’infanticides (87) et de suppressions d’enfants (23) entre 1870 et 1914, mettent en lumière l’importance des grossesses non désirées, ainsi que l’immense solitude de ces femmes, de la découverte de la grossesse aux procès. Le passage à l’acte est bien souvent décidé et réalisé par une femme seule, parfois avec la complicité d’une parente ou d’une avorteuse, en espérant ne pas trop attirer l’attention de l’entourage. Les hommes quant à eux sont très peu présents dans ces affaires, soit parce qu’ils ont abandonnés leur maîtresse durant la grossesse, soit parce qu’ils ne participent pas à l’avortement ou l’infanticide par ignorance ou désintérêt. Ils sont donc très rarement impliqués par la justice et poursuivis (2 % d’hommes dans les procédures d’infanticides/suppressions d’enfants et 10,7 % pour les avortements en Charente-Inférieure).
2. Suicide, vitriol, adultère : l’honneur en jeu et le traitement différencié des individus
Dans un siècle qui invente la distribution de médailles et de décorations majoritairement pour les hommes, la question de l’honneur est centrale[42]. Celui-ci est alors pensé comme essentiellement masculin, tout comme la problématique de l’adultère dont la différence de traitement est au bénéfice des hommes. Pour autant, les femmes tiennent également à leur honneur et c’est un motif souvent invoqué dans les affaires de vitriol, mais aussi en cas de suicides ou de tentatives.
Pour la Charente-Inférieure, 127 cas d’adultères ont pu être relevés. Jusqu’en 1899, les épouses sont plus lourdement condamnées que leurs amants, ces derniers n’étant d’ailleurs le plus souvent tout simplement ni connus ni dénoncés par leurs partenaires. En revanche, les maris s’estimant bafoués n’hésitent pas à dénoncer leurs femmes. Ces dernières sont alors condamnées majoritairement à de la prison (66 % des femmes entre 1870 et 1899 contre 34 % des hommes) dans un but dissuasif, mais aussi d’exemplarité. Après 1899, les peines tendent à être plus équitables entre les deux personnes impliquées et les condamnations à la prison se réduisent considérablement, jusqu’à devenir quasi nulles à partir de 1910, accompagnant le mouvement qui, depuis 1895, milite en faveur de la suppression de toute sanction pénale de l’adultère[43]. Face au peu de possibilités légales des femmes en cas d’adultère de leur époux, certaines n’hésitent pas à trouver d’autres moyens, plus ou moins radicaux. En 1895, une femme qui a des doutes sur le motif invoqué par son mari pour s’absenter la journée demande à une amie de garder son magasin et se met en route vers le chalet dont il a la garde l’hiver. Sur place, elle s’empare d’une échelle, grimpe jusqu’au premier étage, brise un carreau et constate la tromperie. Le mari et la maîtresse s’enfuient alors, poursuivis par l’épouse, sur la plage de Ronce-les-Bains. Cette dernière tente de s’en prendre à sa rivale mais est interrompue par son mari. Selon la presse, qui relate l’affaire, la maîtresse « a reçu une rude correction de son mari et la femme trompée est allée déposer une demande de divorce[44] ». Si l’affaire est d’abord traitée de manière privée, elle devient vite publique. Les protagonistes semblent alors être « punis » mais là encore, c’est la femme adultère qui paie le plus lourd tribut, ayant à subir la violence physique légale de son mari. Ce sont d’ailleurs bien souvent les femmes qui sont victimes des autres femmes dans ce type d’affaire. Ainsi, en 1880, à Saintes, la comtesse de Tilly s’en prend-elle à la maîtresse de son mari qu’elle asperge de vitriol lorsqu’elle passe devant son domicile. Seule femme de la bonne société poursuivie dans ce type d’affaire, Madame de Tilly est acquittée. Pour justifier son geste, elle n’invoque pas son honneur mais celui de ses deux enfants[45].
Si les affaires de vitriol font grand bruit dans la presse, c’est avant tout parce qu’elles sont révélatrices de peurs sociales, essentiellement masculines. C’est ainsi qu’en 1889, un article laisse transparaître ces sentiments :
« Quand donc infligera-t-on aux femmes qui jettent du vitriol aux visages des hommes quand elles ne sont pas contentes, un châtiment exemplaire et qui donnerait à réfléchir à celles qui voudraient commettre de pareils attentats ? À propos d’une simple querelle, d’un bouton mal cousu, vous verrez bientôt les névrosées assurées d’une quasi-impunité, répandre le vitriol à pleins bols[46] […] »
Pourtant, en Charente-Inférieure, seuls 11 cas sont jugés. Là aussi, c’est souvent le motif de l’honneur qui est évoqué, mais aussi le fait de se faire justice soi-même. En effet, un certain nombre de ces femmes, jeunes, sont séduites puis abandonnées, parfois enceintes, par les hommes auxquels elles s’en prennent. N’ayant aucun moyen légal de les contraindre, elles entendent leur faire porter leur part de responsabilité en les attaquant et en les marquant pour le reste de leur vie. Séduite par son amant, Marie Ducharles finit par tomber enceinte mais celui-ci refuse de l’épouser et de reconnaître l’enfant. Il répand même des rumeurs au sujet de ses mœurs. Elle le retrouve à Royan où il travaille comme cocher pendant la saison balnéaire, mais n’obtient pas plus gain de cause, lui et ses camarades se moquant d’elle et sous-entendant qu’elle a de nombreux amants. C’est là qu’elle se décide à faire usage du vitriol acheté un peu plus tôt, dans le but de se faire justice. L’enquête démontre la bonne réputation de Marie Ducharles face à celle, déplorable, de sa victime. Elle est acquittée, sous les applaudissements du public[47].
Ne pas supporter de voir son honneur et sa réputation entachés peut aussi se révéler être un motif de suicide ou de tentative. La presse les qualifie souvent de « chagrins domestiques », mais ils cachent parfois des abandons de femmes ou de jeunes filles laissées enceintes et qui ont peur de perdre leur emploi, de ne pas pouvoir s’en sortir ou des réactions de leurs familles. En 1873, Marguerite Sarrazin, 24 ans, domestique, se suicide alors qu’elle est malade. Ses maîtres ne disent que du bien d’elle, mais le voisinage fait courir des rumeurs laissant penser qu’elle est enceinte. C’est ce motif, entachant sa réputation, qui la pousse à commettre son geste. En 1899, Augusta Thiébaud, domestique devant quitter sa place et brouillée avec sa famille, tente de se suicider. Elle se voyait déjà dans la plus grande misère et sans ressources ni soutien, ce qui a déterminé son passage à l’acte[48].
La question de la préservation de l’honneur est donc centrale entre 1870 et 1914 et peut mener à des actes extrêmes, parmi lesquels le suicide ou l’agression au vitriol. Il est alors questions ici des moyens mis en œuvre par les femmes pour tenter de préserver honneur et réputation. Si les hommes peuvent également avoir recours à ces extrémités, ils sont plus nombreux à user de violences psychologiques ou physiques envers les femmes.
3. L’ultime sentiment de contrôle masculin sur les femmes : menacer, battre, tuer
Lorsque l’on est à court de recours légaux pour garder l’ascendant sur une femme, la violence, psychologique et/ou physique, devient alors la seule alternative. Si le Code civil reconnaît les mauvais traitements, « excès, sévices ou injures graves » (article 231) comme motifs de divorce, le Code pénal excuse le meurtre de l’épouse par l’époux en cas de flagrant délit d’adultère au domicile conjugal (article 324).
En Charente-Inférieure, on relève 30 meurtres et 33 tentatives sur des femmes entre 1870 et 1914. La majorité (61,9 %) sont des uxoricides. La justice du XIXe siècle s’empare de ces questions et les magistrats, faute de pouvoir changer les lois, procèdent à des ajustements pratiques pour rendre visibles, pensables et condamnables les violences conjugales[49]. Ainsi, 29,3 % des hommes jugés sont acquittés ou reconnus non-coupables, 27,7 % sont condamnés aux travaux forcés, 20 % à la réclusion et 21,5 % à la prison.
Les interrogatoires mettent en lumière les logiques qui poussent les hommes à tuer les femmes. De même, leurs défenses prennent appui sur des représentations communes qui relèvent de biais de genre et renseignent sur les rapports sociaux de sexe[50]. Parfois, l’accusé affirme être trompé par sa victime pour justifier son acte. Lorsqu’il tente d’excuser sa tentative de meurtre sur son épouse, Émile Dubois explique aux magistrats : « Si j’ai agi comme je le faisais c’est parce que j’étais convaincu que ma femme me faisait des infidélités[51] ». À cela s’ajoute des motifs, tel le fait qu’elle ne remplissait pas bien le rôle attendu d’elle. Interrogé dans l’affaire précédente, le fils d’Émile Dubois raconte ainsi que son « père adressait quelques reproches à [sa] mère parce qu’au moment où [ils] arrivi[aient] pour prendre [leur] repas, après [leur] travail, il n’y avait jamais rien de fait[52] […] ». D’autres fois, c’est parce que la victime menaçait de quitter son agresseur ou l’avait fait que celui-ci s’est cru en droit d’attenter à sa vie. Ainsi Marie-François Lorgue tente de justifier le meurtre de sa femme en précisant : « Je voulais absolument obliger ma femme à revenir avec moi par tous les moyens[53] ». En effet, plusieurs accusés laissent transparaître un fort sentiment de possession juste avant le passage à l’acte. Tout en déchargeant son pistolet sur son épouse, Anatole Pilain s’exclame : « Malheureuse, tu ne seras pas à d’autres qu’à moi[54] ».
Les motifs avancés sont donc nombreux et il ne s’agit pas ici de tous les présenter. Dans une société où la réputation et l’honneur sont essentiels, ces exemples mettent en lumière le fait qu’il peut sembler nécessaire à certains hommes de tuer, mutiler, handicaper une femme afin de rester le maître[55]. Malgré ces attaques, répétitives et d’une grande violence, presque toutes les femmes se défendent d’une ou plusieurs manières. Certaines rendent les coups qui leurs sont portés. L’un des témoins de l’affaire Pilain rapporte qu’elle a vu les époux se donner mutuellement des coups, bien que ce soit lui qui fasse le plus souvent usage de violence[56]. D’autres déposent des plaintes contre leurs époux et/ou demandent une séparation de corps ou un divorce. Ainsi Rose Geay dépose-t-elle plainte contre son mari pour « menaces exercées envers elle ». Elle en profite pour relater l’ensemble des sévices qu’il lui fait subir. Le lendemain, elle introduit également une demande de divorce contre son mari[57].
« Si l’on admet que la violence des hommes envers les femmes a pour but de les tenir sous contrôle, alors cela explique aussi bien la violence privée que la violence publique[58] ». En effet, les violences à l’égard des femmes, qu’elles soient institutionnelles, professionnelles ou privée, restent multiformes. Contraindre ou contrôler un individu selon des critères de genre représente ainsi une forme de violence.
Malgré tout, les problématiques domestiques de contrôle et de contrainte par une violence plus ou moins flagrante et légale ne sont pas au centre des revendications des groupes féministes de la fin de la période qui se concentrent davantage sur le travail ainsi que les droits sociaux et politiques. Pour autant, les résistances quotidiennes sont de plus en plus visibles, notamment grâce à la presse, et le regard de la société évolue peu à peu, spécialement lorsque les violences débordent sur l’espace public.
Les républicains, réellement au pouvoir à compter des années 1880, tendent à s’enorgueillir des progrès qu’ils ont fait faire aux droits des femmes, surtout en termes d’éducation[59]. Ainsi, Jean-Octave Lauraine, député de Saintes de 1898 à 1923 mais aussi président du groupe de la Gauche radicale à la Chambre, déclare, dans un discours de juillet 1912 à l’occasion d’une distribution de prix au collège de Jeunes Filles : « profitez, mesdemoiselles […] de ce qu’ont fait les pouvoirs publics, les majorités républicaines persistantes qui, inlassablement, ont travaillé à débarrasser la route que vous suivez de tous ses encombrements moraux et juridiques[60] ». Représentatif de l’état d’esprit dominant, en Charente-Inférieure, en France et dans son parti politique, il se permet toutefois de souligner que ces progrès sont suffisants. Ainsi fait-il remarquer aux jeunes filles qu’il « ne faut pas que cet enseignement vous porte à vous éloigner de la magnifique condition sociale que vous êtes appelées à remplir. Il faut que vous ayez au foyer, que vous devez créer […] – parce que c’est votre devoir, et qu’ayant reçu la vie vous devez avoir à honneur […] de la rendre à votre tour – la deuxième place[61] ». Après cette réassignation de chacun à ses fonctions de genre et soucieux de préserver le modèle social et familial en place, il se permet d’ajouter une mise en garde cherchant à « prémunir [les jeunes élèves] contre cette stupide tendance au féminisme qui tend à faire des femmes des hommes[62] ». Cet avertissement ne semble pas avoir été entendu de toutes puisque la ville de Saintes accueille moins de deux ans plus tard, en janvier 1914, la première société féministe de la Charente-Inférieure.
[1] Hanmer, Jalna, « Violence et contrôle social des femmes », dans Nouvelles questions féministes. Revue internationale francophone, novembre 1977, p. 85.
[2] Bougle-Moalic, Anne-Sarah, Le vote des Françaises. Cent ans de débats, 1848-1944, Presses Universitaires de Rennes, Collection « Archives du féminisme », Rennes, 2021, p. 86.
[3] En référence au général Boulanger et au mouvement politique populiste français qui en découle entre 1885 et 1891.
[4] Gargam, Adeline, Lançon, Bertrand, Histoire de la misogynie. Le mépris des femmes de l’Antiquité à nos jours, Les Éditions Arkhê, Paris, 2020, p. 19.
[5] Ripa, Yannick, Les femmes actrices de l’histoire de France de 1789 à nos jours, Armand Colin, Paris, 2010, p. 26 ; Bannour, Wanda, « L’idéologie du corps médical français au XIXe siècle », dans Les Cahiers du GRIF, n° 47, 1993, p. 51-59.
[6] Mortas, Pauline, « Articles intimes pour dames et messieurs » : une histoire du marché lié à la sexualité (France, années 1880-années 1930), thèse de doctorat en Histoire sous la direction de Rasmussen, Anne, Chaperon, Sylvie et Kalifa, Dominique, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue en décembre 2023 ; Sohn, Anne-Marie, Chrysalides, femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles), Paris, Publication de la Sorbonne, 1996.
[7] Statistiques établis à partir du relevé des peines pour adultère (127 cas recensés, 107 peines connues) dans la presse de Charente-Inférieure sur https://www.retronews.fr, plateforme de mise en ligne de la presse par le BNF.
[8] Gargam, Adeline, Lançon, Bertrand, Histoire de la misogynie. Op. Cit., p. 113-115.
[9] Henck, Véronique, « Images de la femme idéale au XIXe siècle », dans Revue des sciences sociales de la France de l’Est, n° 23, 1996, p. 25-30.
[10] https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/histoire-des-femmes-ecrire-l-histoire-des-femmes-7-10-le-travail-des-femmes-16-paysannes-17-le-travail-domestique-18-ouvrieres-1ere-diffusion-21-au-23-03-2005-2340140, par Michelle Perrot, écouté le 21 janvier 2023.
[11] AD 17, 4M9/1, Réunions publiques, 1907-1921, Courrier du Commissaire central de La Rochelle au Préfet, 22 mai 1910.
[12] Idem.
[13] De telles initiatives se multiplient, au même moment, dans plusieurs autres départements.
[14] Idem, 8 juin 1910.
[15] Foucault, Michel, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1975. À l’origine, le terme désigne l’architecture carcérale imaginée par les frères Jeremy et Samuel Bentham qui a pour objectif de permettre à un gardien de pouvoir observer l’ensemble des prisonniers depuis un même point central. Cela avait pour but de donner aux prisonniers l’impression d’être constamment surveillés, sans vraiment le savoir. Michel Foucault en fait le modèle abstrait d’une société disciplinaire, axée sur le contrôle social.
[16] AD 17, 1Y/142, Requêtes et réclamations des détenues femmes (1830-1924) – Lettre transmise par l’avocat de la prévenue, 12 août 1909.
[17] AD 17, 1T/127, Révocations et suspensions, Affaire Beaudouin – Courriers entre le Préfet et l’Inspecteur, mai 1904-février 1906.
[18] AD 17, 1T/59, Laïcisation des écoles de filles (1896-1904) – Lettre de l’Inspecteur d’académie au Préfet, 12 mai 1900.
[19] Idem.
[20] Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste, De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration, Tome 2, Paris, J.B. Baillière, 1836, p. 513-514.
[21] Corbin, Alain, Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Flammarion, coll. Champs Histoire, 1982.
[22] Archives Municipales de Rochefort (AMR), 1J9 et J10 Prostitution ; VRAC 2I – Extraits des règlements.
[23] AMR, J9, Extrait de règlement.
[24] Il s’agit d’une carte sanitaire délivrée par la police aux « filles » exerçant la prostitution en dehors des maisons closes. Elle permet aux autorités de recenser, surveiller et contrôler les prostituées.
[25] Idem.
[26] AMR, J9 et VRAC 2I – Extraits des règlements.
[27] AMR, J9 – Lettre de la fille Roblet, 25 juillet 1872.
[28] Idem – Extrait de règlement.
[29] Idem – Lettre de la veuve Dupont au maire de Rochefort, 12 juillet 1873.
[30] AMR, J10, Rapport du commissaire central au maire de Rochefort, 22 mai 1891.
[31] AMR, J9 et J10, Extraits des règlements.
[32] AMR, J9, Lettre de Marguerite Vergeade au maire de Rochefort, 4 octobre 1871.
[33] AMR, J11, Lettre d’Henriette Rideau au maire de Rochefort, 30 octobre 1905.
[34] Idem, Lettre de la veuve Blum au maire de Rochefort, 5 mars 1902.
[35] BNF, Les Tablettes des Deux-Charentes, 25 janvier 1873, page 3, colonne 4.
[36] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 19 mars 1898, page 3, colonne 3.
[37] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 1er avril 1899, page 2, colonne 4.
[38] BNF, L’Écho rochelais, 14 juin 1899, page 3, colonne 4.
[39] Zylberberg-Hocquard, Marie-Hélène, « Femmes sans droit/Droits des femmes au XIXe siècle. Les femmes face à la citoyenneté », dans Les cahiers du genre, n° 6, 1993, p. 11-27.
[40] houbre, Gabrielle, “Au XIXe siècle, le retour en force d’une sexualité procréative et normée », propos recueillis par Marina bellot, dans Retronews, site de presse de la BNF, mars 2024, https://www.retronews.fr/societe/interview/2024/03/04/sexualites-au-xixe-siecle, consulté le 4 août 2024.
[41] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 23 février 1871, page 3, colonne 6.
[42] Dumons, Bruno, Pollet, Gilles (dir.), La Fabrique de l’Honneur. Les médailles et les décorations en France, XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009, p. 17.
[43] Martin-Fugier, Anne, La Bourgeoise, Les Éditions Fayard, Pluriel, Rennes, 2014, p. 107.
[44] BNF, L’Écho saintongeais, 28 avril 1895, page 3, colonne 2.
[45] AD 17, 2U3/1683, Affaire Girard du Demaine, Marie-Amélie, épouse Legardeur de Tilly, vitriol.
[46] L’Écho rochelais, 12 janvier 1889, page 3, colonne 4.
[47] AD 17, 2U3/2376, Affaire Ducharles Marie, 1898, Vitriol ; BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 26 novembre 1898, page 2, colonne 5.
[48] BNF, Le Phare des Charentes, 7 juillet 1899, page 3, colonne 3.
[49] Vanneau, Victoria, « L’invention juridique des violences conjugales au XIXe siècle », dans Les cahiers de la justice, n° 2, 2016/2, p. 305.
[50] Giacinti, Margot, « “Débarrasser la société de femme[s] de ce genre-là”. Appréhender les archives judiciaires au prisme du genre pour enquêter sur les féminicides », GLAD!, 11 | 2021. Le biais de genre est ce que l’on projette sur l’autre en raison de son genre. Il reflète les associations que nous avons intégrées au fil de notre vie, dans notre éducation et nos relations sociales.
[51] AD 17, 2U3/2472, Affaire Dubois Émile, Tentative de meurtre, 1901.
[52] Idem.
[53] AD 17, 2U3/2495, Affaire Lorgue Marie-François, Meurtre, 1902.
[54] AD 17, 2U3/1999, Affaire Pilain Anatole, Tentative d’assassinat, 1887.
[55] Hanmer, Jalna, « Violence et contrôle social des femmes », Op. Cit., p. 79.
[56] AD 17, 2U3/1999, Affaire Pilain Anatole, Op. Cit..
[57] AD 17, 2U3/2360, Affaire Terrien Charles-Philippe, Meurtre, 1897.
[58] Hanmer, Jalna, « Violence et contrôle social des femmes », Op. Cit., p. 79.
[59] Entre 1870 et 1880, la République reste fragile. Les républicains sont à l’origine du nouveau régime mais les résultats des élections restent favorables aux monarchistes. Pour autant, après le départ de Mac Mahon, les républicains s’imposent peu à peu et prennent réellement le pouvoir à compter de 1879.
[60] BNF, L’Indépendant de la Charente-Inférieure, 23 juillet 1912, page 2, colonnes 2 à 4.
[61] Idem.
[62] Idem.
Bibliographie
BANNOUR, Wanda, « L’idéologie du corps médical français au XIXe siècle », dans Les Cahiers du GRIF, n° 47, 1993.
BOUGLE-MOALIC, Anne-Sarah, Le vote des Françaises. Cent ans de débats, 1848-1944, Presses Universitaires de Rennes, Collection « Archives du féminisme », Rennes, 2021.
CORBIN, Alain, Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Flammarion, coll. Champs Histoire, 1982.
DUMONS, Bruno, POLLET, Gilles (dir.), La Fabrique de l’Honneur. Les médailles et les décorations en France, XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009.
FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1975.
GARGAM, Adeline, LANÇON, Bertrand, Histoire de la misogynie. Le mépris des femmes de l’Antiquité à nos jours, Les Éditions Arkhê, Paris, 2020.
GIACINTI, Margot, « “Débarrasser la société de femme[s] de ce genre-là”. Appréhender les archives judiciaires au prisme du genre pour enquêter sur les féminicides », GLAD!, 11 | 2021.
HANMER, Jalna, « Violence et contrôle social des femmes », dans Nouvelles questions féministes. Revue internationale francophone, novembre 1977.
HENCK, Véronique, « Images de la femme idéale au XIXe siècle », dans Revue des sciences sociales de la France de l’Est, n° 23, 1996.
HOUBRE, Gabrielle, “Au XIXe siècle, le retour en force d’une sexualité procréative et normée », propos recueillis par Marina BELLOT, dans Retronews, site de presse de la BNF, mars 2024, https://www.retronews.fr/societe/interview/2024/03/04/sexualites-au-xixe-siecle, consulté le 4 août 2024.
MARTIN-FUGIER, Anne, La Bourgeoise, Les Éditions Fayard, Pluriel, Rennes, 2014.
MORTAS, Pauline, « Articles intimes pour dames et messieurs » : une histoire du marché lié à la sexualité (France, années 1880-années 1930), thèse de doctorat en Histoire sous la direction de RASMUSSEN, Anne, CHAPERON, Sylvie et KALIFA, Dominique, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue en décembre 202.
PARENT-DUCHATELET, Alexandre-Jean-Baptiste, De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration, Tome 2, Paris, J.B. Baillière, 1836.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/histoire-des-femmes-ecrire-l-histoire-des-femmes-7-10-le-travail-des-femmes-16-paysannes-17-le-travail-domestique-18-ouvrieres-1ere-diffusion-21-au-23-03-2005-2340140, par Michelle PERROT, écouté le 21 janvier 2023.
RIPA, Yannick, Les femmes actrices de l’histoire de France de 1789 à nos jours, Armand Colin, Paris, 2010.
SOHN, Anne-Marie, Chrysalides, femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles), Paris, Publication de la Sorbonne, 1996.
VANNEAU, Victoria, « L’invention juridique des violences conjugales au XIXe siècle », dans Les cahiers de la justice, n° 2, 2016/2.
ZYLBERBERG-HOCQUARD, Marie-Hélène, « Femmes sans droit/Droits des femmes au XIXe siècle. Les femmes face à la citoyenneté », dans Les cahiers du genre, n° 6, 1993.